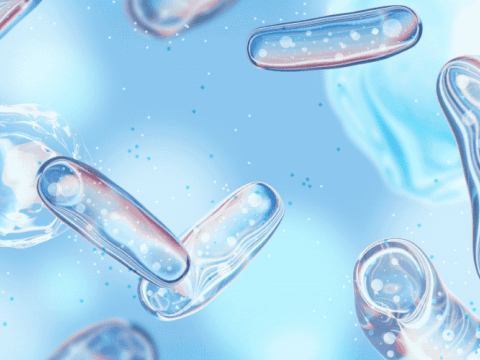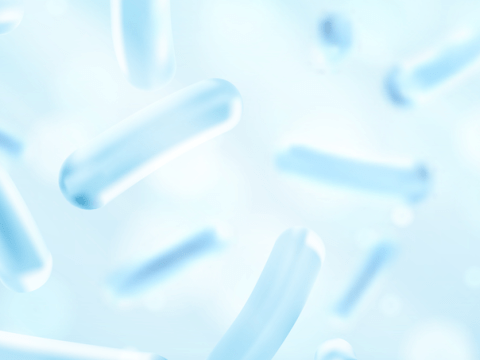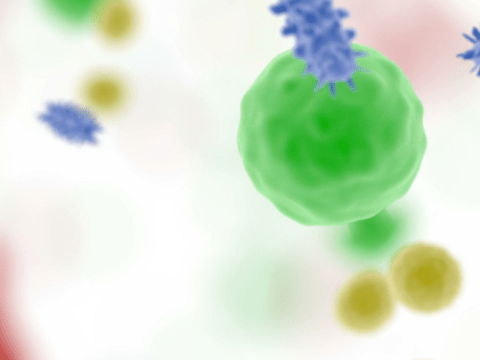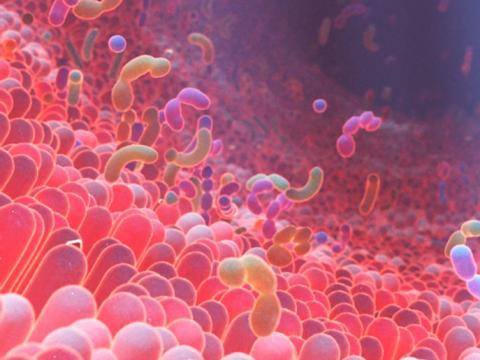Microbiotes
Un microbiote est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) vivant dans un environnement spécifique. Il existe ainsi un microbiote du sol, un microbiote de l’océan, mais surtout il existe des microbiotes associés au corps humain : microbiote cutané, microbiote vaginal…et le plus étudié, le microbiote intestinal.
Chaque individu a un microbiote intestinal qui lui est propre, constitué d’environ 160 espèces bactériennes différentes.
-
10 000 milliards de bactéries composent le microbiote intestinal
540 000 c'est le nombre de gènes microbiens que porte en moyenne un individu
-
160 c'est le nombre d'espèces différentes de bactéries qui composent le microbiote d'un individu sain
Filtrer les articles dédiés à la thématique Microbiotes
-
![Microbiote_intestinal_histoire_enfant.png Le microbiote intestinal écrit l'histoire de votre enfant]()
-
![vignette-equilibre-flore-vaginale.jpg Équilibre flore vaginale]()
Confort intime : restaurer et préserver naturellement l’équilibre de la flore vaginale
Le bien-être intime est un élément essentiel de la santé féminine, pourtant il reste parfois méconnu ou entouré de tabous. Au cœur de cet équilibre se trouve la flore vaginale, un microbiote complexe qui joue…Lire l'article
-
![Banniere_idees_recues_probiotiques.png 10 idées reçues sur les probiotiques]()
Probiotiques : la vérité sur 10 idées reçues
Depuis plus de 30 ans, le laboratoire PiLeJe s’impose comme un pionnier dans l'étude des probiotiques. Si ces micro-organismes sont aujourd’hui reconnus pour leurs bienfaits sur la santé, de nombreuses idées…Lire l'article
-
![banniere-aliments-pour-microbiote.png aliments pour le microbiotes]()
Quelle alimentation pour un bon microbiote ?
II existe un lien entre la bonne santé du microbiote intestinal et notre propre bonne santé. Le microbiote intestinal se nourrit à partir de notre alimentation. Grâce à l’alimentation, il est possible de…Lire l'article
-
![le-microbiotes-ou-les-microbiotes.png image bactéries]()
Le microbiote ou les microbiotes ?
Un microbiote est l’ensemble des bactéries et autres micro-organismes vivants qui vivent dans un environnement spécifique. Il existe en réalité différents microbiotes dans l’organisme : le microbiote de la…Lire l'article
-
![Bandeau FODMAPs Bandeau FODMAPs]()
Qu'est-ce qu'un régime pauvre en FODMAPs ?
Certains déséquilibres du microbiote nécessitent une adaptation de l’alimentation. Dans certains cas, il pourra être intéressant de mettre son organisme au repos et de limiter les perturbateurs tels que le…Lire l'article
-
![Bandeau comment enrichir son microbiotes Bandeau comment enrichir son microbiotes]()
Comment enrichir son microbiote ?
Constitués de plusieurs milliards de bactéries, les microbiotes jouent de nombreux rôles essentiels au sein de l’organisme. L’équilibre de ces microbiotes est fragile. Une attention particulière doit être…Lire l'article
-
![vignette peau La peau, le plus gros organe du corps humain]()
La peau, plus gros organe du corps humain
La peau n'est pas juste une simple enveloppe. De composition complexe, elle intéragit avec l'environnement et occupe des fonctions vitales.Lire l'article
-
![Vignette butyrate vignette butyrate]()
L’importance des fibres pour un microbiote en bonne santé
Le microbiote intestinal est composé de 10 000 milliards1 de bactéries qui évoluent au sein du tube digestif. Les prébiotiques nourrissent des bactéries favorables à un microbiote intestinal en bonne…Lire l'article
-
![vignette-microbiote-intestinal-sante Microbiote intestinal]()
Qu'est-ce que le microbiote intestinal ?
Aujourd’hui considéré comme un organe à part entière de l’organisme humain, le microbiote intestinal joue un rôle décisif dans notre santé. Autrefois appelé « flore intestinale », le microbiote intestinal est…Lire l'article
-
![Vignette - Probiotiques : comment bien les choisir ? Vignette - Probiotiques : comment bien les choisir ?]()
Probiotiques : comment bien les choisir ?
L’efficacité d’un probiotique est non seulement souche et dose dépendante, mais repose également sur d’autres critères indispensables à connaître pour faire les bons choix.Lire l'article
-
![Des prébiotiques pour améliorer le sommeil Des prébiotiques pour améliorer le sommeil]()
Des prébiotiques pour améliorer le sommeil
Une étude de l’Université du Colorado démontre que les prébiotiques peuvent constituer une solution possible pour mieux faire face au stress, au même titre que le yoga, la méditation ou encore l’exercice…Lire l'article
Recevez notre newsletter
Chaque mois dans votre boîte mail l’actualité PiLeJe :
Informations santé, évènements et temps forts du Laboratoire !